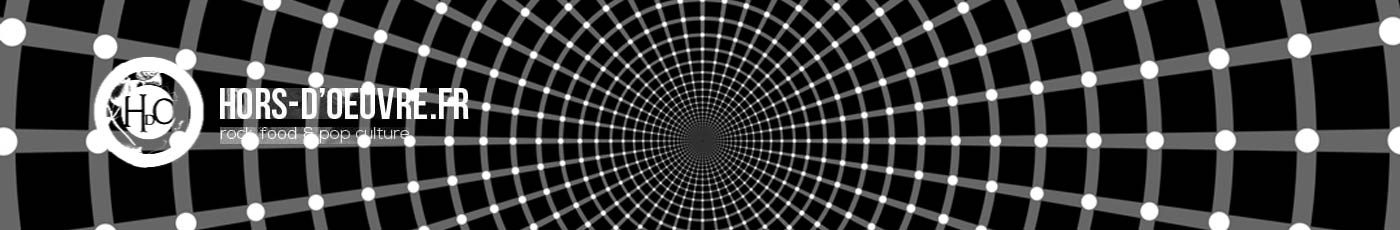Un printemps au 4 vents : séléction 2020
En ce printemps 2020 aux relents apocalyptique, les quatre cavaliers de la rédemption musicale n’ont pas le look escompté. Chevauchant des styles musicaux aux antipodes les uns des autres, ils résument en quatre albums indispensables nos luttes intérieures, entre sidération, colère, espoirs insensés et apaisement.
Ghostpoet – Poète visionnaire
10 ans déjà que l’on suit la carrière d’Obara Ejimine, aka Ghostpoet, dandy britannique et conteur tragique d’une épopée lancinante, à mi-chemin entre trip-hop, jazz et electronica, et l’on mesure le chemin parcouru depuis Peanut Butter Blues & Melancoly. I Grow Tired But Dare Not To Fall Asleep, son dernier opus, est un concentré de noirceur et d’élégance désespérée. Atmosphérique, totalement cinématographique – on se prend à rêver qu’il signe la bande-son d’un film noir ou d’une série d’anticipation –, à la fois la suite logique des albums précédents et passage à la vitesse supérieure avec ses arrangements complexes et ses distorsions haletantes. « I am alive, You are alive, We are alive » psalmodie Ghostpoet sur le premier titre de l’album, Breaking Cover, avant d’enchaîner quelques couplets plus loin par « I wanna die, You wanna die, We wanna die… » : on ne saurait mieux résumer l’esprit du temps. Glissant peu à peu en dix titres imparables vers un songe suffocant et cathartique, évoquant tour à tour Tricky, Radiohead ou Gil Scott-Heron, Ghospoet ressemble au croque-mitaine qui hante nos cauchemars : terrifiant, singulier, et éminemment désirable.
Grow Tired But Dare Not To Fall Asleep, 1er mai 2020 chez Play It Again Sam (Pias)
Pokey LaFarge – Crooner de fond
En quittant Saint-Louis, Missouri, Pokey LaFarge s’est perdu en route et a touché le fond. Il aurait du le savoir, à Los Angeles, on se retrouve presque à coup sûr à boire en tête avec de vieux démons. Trop d’alcool, trop de concerts, trop de femmes, trop de… qu’importe. Avec sa gueule d’acteur des années 40, Andrew – Heissler de son vrai nom – se retrouve à jouer son propre rôle dans un film qui lui échappe, celui de la vie telle qu’on la chante dans les vieux blues qui broient du noir. Sans doute a t-il écrit certains des titres de Rock Bottom Rhapsody avant sa descente aux enfers, pourtant ils ont tous cette politesse du désespoir, cette suavité dansante qui le caractérise. Huitième album et montée en puissance, Pokey saute d’un style à l’autre et fait le grand écart avec agilité : americana, boogie-woogie, rythm’n blues, ballades façon crooner, tout y passe. Et c’est bon. Fuck Me Up chante t-il ironiquement – titre irrésistible d’ailleurs –, d’accord, mais ce serait dommage, même si on a, en ce moment, tous un peu envie de se foutre en l’air. L’album parfait pour attendre le déconfinement, ou la rédemption.
Rock Bottom Rhapsody, 10 avril 2020 chez New West Records
Chicken Diamond – Enragé solitaire
Il était une fois dans l’Est un guitariste aussi enragé que les Stooges, aussi âpre qu’un bluesman du delta et aussi « bad » que tous les « fils de son » réunis. Un Bad Man donc, rancunier comme son cinquième album, qui vient vous sonner les cloches aussi sûrement que Pâques 2020 vous aura donné la gueule de bois. Et il faut bien avouer que le bonhomme est toujours aussi droit dans ses bottes, nerveux comme un iguane à qui on aurait osé demander son attestation. Toujours prêt à gueuler du blues et à vous en balancer plein la tronche en mode One Man Band, Chicken Diamond serait plutôt du genre poulet nourri aux amphétamines, même s’il nous gratifie de quelques ponts et de relatives accalmies comme l’excellent Don’t Get Me Wrong ou le très noir Bad Man – une reprise des Oblivians paraît-il, mais si c’est le cas… méconnaissable -, qui n’est pas sans évoquer les errances crépusculaires d’un Mark Lannegan. « No Escape… you’re alone ! » braille t-il de sa voix éraillée sur le titre du même nom, voilà qui résume à merveille l’esprit de cet album impeccablement ficelé et l’on n’a qu’une hâte, le voir à nouveau sur scène où il donne à chaque fois toute la mesure de son rock énervé, brut et sans compromis.
Bad Man, 14 avril 2020 chez Beast Records
Dakhabrakha – Sorciers polyphoniques
Quatuor ukrainien né au théâtre Dakh à Kiev en 2004, Dakhabrakha a su imposer depuis ses racines puisées dans le folklore de la « Petite Russie » et Alambari, leur dernier album a tout d’un état de grâce. Ne vous fiez pas à leurs tenues étrangement inspirées des costumes traditionnels ukrainiens, merveilles d’esthétique, la musique de Dakhabrakha – 3 femmes pour 1 homme, bouffée d’air frais ! – est tout sauf passéiste. Bien loin d’Alyona Alyona, ils ont pourtant en commun avec elle l’art du crossover, la liberté de ton et l’amour d’une langue singulière, symbole désormais d’émancipation culturelle et politique. Musicologues avertis, musiciens chaméléons jouant tour à tour du darbuka, de l’accordéon, du violoncelle, de la guimbarde (la liste est longue !), ils ont fait de la polyphonie, spécificité à priori ukrainienne par rapport à leurs voisins russes, leur marque de fabrique. Et quelles voix… Alambari commence et se termine comme un rêve avec le morceau du même nom. Un rêve éveillé où défilent dans le désordre des églises aux bulbes dorés, un cabaret foutraque, de jeunes amoureuses, un Sonnet de Shakespeare, une chanson en allemand (Im Tanzen Liebe), des danses endiablées… Pour s’évader.
Alambari, 27 mars 2020
A l’heure où nous écrivons cette chronique, la situation de l’industrie musicale, principalement celle des labels indépendants et du spectacle vivant, étant particulièrement dramatique, nous ne saurions trop engager nos lecteurs à se procurer, s’ils le peuvent, ces albums sous format matérialisé (livraison via des disquaires indépendants, achats en direct auprès des labels, etc…), et à réserver, dès que cela sera possible, une place pour un de leurs concerts.